Des mines en France ? Une controverse entre technique et territoire
La France, dans une dynamique européenne plus large, envisage de relancer son activité minière. Le but affiché : assurer notre approvisionnement en matières premières, tout particulièrement pour les métaux indispensables à la transition écologique et énergétique. Dans les régions où les prospections débutent, les populations locales se mobilisent. La controverse qui en résulte prend des airs de débat technique. Mais derrière se cachent des enjeux politiques et économiques plus profonds, qui questionnent le rapport des citoyens à leur territoire, et sur lesquels se penche la recherche académique.
[divider style= »normal » top= »20″ bottom= »20″]
[dropcap]P[/dropcap]our atteindre le petit village de Couflens, situé dans les Pyrénées ariégeoises, il n’y a qu’une seule route. Une voie goudronnée qui serpente le long du Salat, torrent encaissé dans la vallée à laquelle il donne son nom. À droite comme à gauche, la montagne domine. Lorsque les pans de roches s’écartent au détour d’un virage, on peut apercevoir à quelques kilomètres les pics marquant le fond de la vallée. Au-delà, c’est l’Espagne. Passé Couflens dans la direction de la frontière, la départementale se poursuit vers le hameau de Salau. On y trouve quelques maisons en pierre qui bordent la route, une vieille église romane, une auberge… et des petits immeubles de toute évidence plus récents. Ces logements HLM construits à Salau dans les années 1970 détonnent avec le décor bucolique et pittoresque environnant. Ils sont l’un des derniers témoignages du passé minier de la région.
Entre 1971 et 1986, plus de 12 000 tonnes de trioxyde de tungstène ont été extraites de la montagne alentour. L’activité avait alors fait grimper la population de Couflens et de ses environs jusqu’à près de 400 habitants en 1975. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 80. La mine fait partie de la mémoire des anciens, et les randonneurs de passage ont remplacé les mineurs sédentaires. L’histoire aurait pu s’arrêter là si en novembre 2014 la société Variscan Mines n’avait pas sollicité l’octroi d’un permis exclusif de recherche minière (PERM) sur la commune de Couflens. L’objectif ? Explorer les sols sur une superficie de 42 km² à la recherche de tungstène, d’étain, d’or, d’argent, de cuivre ou encore de bismuth ou de tantale. Deux ans plus tard, le 21 octobre 2016, le secrétariat d’État chargé de l’industrie annonçait l’attribution de ce permis à Variscan Mines.
Cette décision est le reflet d’une volonté politique nationale. Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron ont tous deux, durant leur mandat de ministre de l’Économie, rappelé leur souhait de voir des mines rouvrir en France. Ils synchronisaient alors l’État avec les ambitions de l’Union Européenne d’établir une souveraineté dans l’acquisition des matières premières considérées comme stratégiques pour l’industrie. En 2011, la Chine contrôlait plus de 97 % de la production mondiale de terres rares, essentielles pour les nouvelles technologies, tout en n’abritant « que » 50 % des réserves terrestres connues. Un monopole qu’elle détient également sur d’autres ressources minérales, comme l’antimoine, et qu’elle partage avec la Russie sur l’aluminium. Ce rôle de leader dans la production de certaines matières premières est utilisé par la République populaire comme une arme. Lors d’une crise en mer de Chine en novembre 2010, elle avait bloqué les exportations de terres rares vers le Japon. Une pression économique majeure dont l’Europe cherche à se prémunir. En avril 2018, le Comité pour les métaux stratégiques — structure française de soutien au ministre de l’Économie et des Finances — classait par exemple le tungstène comme une substance critique de par le fort risque sur son approvisionnement et son importance stratégique pour l’industrie française. Cette volonté de souveraineté trouve ainsi des conséquences jusque dans les villages les plus reculés des Pyrénées. Mais pas sans contestation.
Voix citoyenne
Les choix politiques ne sont jamais unanimes. Et l’idée d’un renouveau minier initiée par le gouvernement précédent et poursuivie par l’actuel n’échappe pas à la règle. Les demandes de PERM déposées par Variscan dans les Pyrénées, mais aussi dans d’autres régions françaises comme la Bretagne, ont rapidement donné naissance à des mouvements d’opposition. Dans les alentours de Couflens et de Salau, des associations se mobilisent contre la réouverture de la mine. Il faut dire que depuis les années 1980, quelques rapports mentionnant la présence d’amiante dans la mine ont vu le jour. Henri Pézerat, toxicologue au CNRS ayant participé à faire interdire l’amiante en France, observait en 1986 des cas de fibrose pulmonaire parmi la population des mineurs. Dans une étude, il expliquait que cette toxicité serait directement liée à l’une des roches de la mine : le skarn, qui contient le tungstate de calcium, dont est extrait le tungstène. La gangue du skarn, c’est-à-dire la partie non minéralisée de cette roche — tout ce qui n’est pas du tungstate de calcium — contiendrait les substances toxiques pour les poumons, et se retrouverait libérée dans l’air lors du minage. Cette étude est aujourd’hui contestée par plusieurs chercheurs, dont Éric Marcoux, professeur à l’Université d’Orléans, qui met en avant des travaux de thèse n’ayant pas révélé la présence d’amiante dans la mine. Des mesures complémentaires sont prévues dans le cadre du PERM, avec pour objectif de lever les doutes et de trancher la question de la présence d’amiante ou non dans les galeries. En attendant, ce point cristallise certaines positions de rejet du projet et structure une partie du débat relatif à la mine de Salau.
La dangerosité de l’exploitation minière pour les employés des sites n’est pas le seul argument avancé par les populations locales qui s’opposent aux différents projets. Julien Merlin, sociologue à Mines Nancy, étudie différents sites de contestation en France, et notamment en Bretagne. Il constate que les PERM de Silfiac, Merléac et Loc-Envel, dans le Morbihan et les Côtes d’Armor, soulèvent des problématiques environnementales. « Les associations mettent en avant l’impact des forages d’exploration sur les aquifères » souligne le chercheur. Selon elles, les masses d’eau souterraines, dont la localisation n’est pas connue avec précision, pourraient être particulièrement mises en danger par les additifs de forage ou les minéraux métalliques toxiques ou radioactifs remontés par les foreuses. « Les débats entre populations et porteurs de projets se focalisent souvent sur des aspects techniques, qui sont différents d’un site à un autre » observe Julien Merlin.

Près de l’entrée des galeries de la mine de Salau, les déchets de l’extraction d’antan ont été amassés en terrils sur les pans de la montagne. Leur couleur ocre les rend particulièrement reconnaissables, tout comme l’odeur de soufre qui s’en dégage. Les métaux (cuivre, plomb, arsenic, antimoine, zinc) qu’ils pourraient relâcher dans les ruisseaux avoisinants en cas d’intempérie sont source de préoccupation pour les collectifs environnementalistes. Photo : BV.
Qu’il s’agisse d’environnement ou de santé publique, les citoyens se structurent pour produire des formes d’expertise alternatives visant à démontrer les dangers d’une mine. En s’appuyant principalement sur les conséquences de l’activité minière française des XIXe et XXe siècles — aujourd’hui disparue pour l’essentiel — ils cherchent à contrebalancer les arguments de « mines propres » ou de « mines responsables » que les industriels et le gouvernement avancent. Pour cela, les collectifs développent un réseau avec des ONG nationales ou internationales. « En Bretagne, des associations très locales comme Vigil’Ouste ou Douar Di Doull organisent des journées d’étude, des festivals ou des manifestations auxquels elles invitent Les Amis de la Terre ou Ingénieurs Sans Frontières, qui sont des mouvements plus importants » décrit le sociologue de Mines Nancy. Ces évènements sont l’occasion de faire venir des experts des « grosses » ONG pour informer les populations locales au sujet des problématiques spécifiques que pose une mine sur un territoire. Le 22 juillet 2017, Ingénieurs Sans Frontières participait au Festival des luttes de Plougonver, organisé par Douar Di Doull en Bretagne. Elle y présentait ainsi les différentes mines existantes, les procédés de transformation du minerai en métal ou encore les éventuels impacts de l’activité.
La mine contemporaine, et ses risques
Au sein de la communauté scientifique académique de nombreux travaux de recherche sont en cours pour mieux identifier, prévenir et maîtriser les risques liés à l’activité minière. Néanmoins, ces risques ne peuvent être totalement éliminés, pas plus que leurs conséquences pour le territoire où s’implantent les mines. Yann Gunzburger est chercheur en géosciences à Mines Nancy. Il a longtemps travaillé sur des problématiques minières purement techniques avant d’explorer des sujets de recherche intégrant les sciences humaines et sociales. Pour lui, « toute activité industrielle comporte une part de risque. C’est vrai aussi pour les activités minières, d’autant qu’elles se font en lien avec le milieu naturel, qui est toujours imparfaitement connu et donc source de nombreuses incertitudes. » Les risques miniers varient grandement d’une exploitation à une autre, ou d’un pays à un autre. Si en Chine, l’extraction de charbon cause probablement aujourd’hui de l’ordre d’une dizaine de milliers de morts par an (pour deux milliards de tonnes de charbon produites annuellement par la Chine), les accidents graves en France avant la fermeture des dernières mines de charbon dans les années 1990-2000 se comptaient en unités (pour environ 10 millions de tonnes produites nationalement). Une différence due au grand nombre de mines que compte la Chine, certes, à la législation respective des deux États également, mais aussi aux moyens techniques, scientifiques et d’ingénierie déployés pour limiter les risques.
Dans une controverse dont les aspects techniques sont aussi importants, David Salze aime à rappeler qu’une mine n’est pas un objet unique et transposable entre les territoires. Ce chercheur d’IMT Mines Alès explique que chaque site possède ses particularités, ses contraintes. Le profil de la mine en sera forcément impacté. « L’exploitation peut être à ciel ouvert ou souterraine » contextualise le chercheur. «Les mines à ciel ouvert sont celles qui ont le plus gros impact visuel. » Dans le secteur minier, les professionnels parlent de « dent creuse ». Un trou creusé dans le terrain qui peut prendre des airs de balafre dans un paysage. L’aménagement de ces sites se fait par terrassements successifs. Plus l’extraction est profonde, plus les gradins de roche sur son périmètre seront nombreux, et fragiles. « Les glissements de terrain et les chutes de blocs sont parmi les grands risques de ces exploitations » pointe David Salze.
Lorsque les gisements se prolongent trop en profondeur, la mine à ciel ouvert n’est plus possible. Bien que les mines souterraines aient l’avantage d’être moins visibles, elles ne sont pas en reste sur la question des risques. Lorsque les galeries sont creusées, les masses de roche peuvent rompre subitement de manière explosive, créant un « coup de terrain ». Plus la mine est profonde, plus les forces et pressions à l’œuvre sont importantes, et plus les coups de terrain sont violents. De plus, que la mine soit souterraine ou à ciel ouvert, les roches extraites sont entreposées à l’extérieur, et parfois même traitées sur place. « Les résidus de traitement des minerais sont stockés derrière des digues, où par exemple les rayons du soleil vont décomposer les résidus cyanurés issus du traitement des minerais d’or » signale David Salze.
La rupture de ces digues peut entraîner des pollutions majeures, surtout lorsque les zones de stockage se remplissent d’eau à la suite de pluies. C’est ce qui est arrivé en Roumanie en 2000. Sur le site de la mine d’or de Baia Mare, des eaux et des boues chargées en cyanure se sont déversées dans le Lapus, une rivière affluente du Danube. La flore et la faune locales ont été lourdement atteintes : destruction des planctons, mort massive de poissons… La catastrophe est aujourd’hui considérée comme le second plus gros désastre écologique européen après Tchernobyl. Des solutions techniques existent pour limiter ces risques. Les sols des bassins sont imperméabilisés par de l’argile, et les stocks de minerais sont recouverts de bâches étanches. Les traitements peuvent également être effectués hors du site, dans des lieux spécifiques et plus sécurisés pour éviter de stocker les roches sur place.
« Les mines ne sont pas neutres ; elles ne peuvent pas être invisibles » assure Yann Gunzburger, de Mines Nancy, tel un écho à la réalité des aléas évoqués. Car au-delà de l’installation elle-même, il faut acheminer sur le site de l’eau, de l’énergie. La matière extraite doit être transportée, ce qui implique souvent de construire de nouvelles routes pour les camions. « Mais ce qui est certain, c’est que nous avons à notre disposition les connaissances pour concevoir des mines exemplaires, à conditions de nous en donner les moyens. La recherche amont peut aider à réduire les incertitudes et le risque » modère le chercheur. Il cite en exemple les outils numériques que ses travaux en géosciences aident à mettre au point. Grâce à la simulation, il est possible de mieux prévoir les microséismes liés aux excavations, d’anticiper les coups de terrain et de mieux maîtriser l’interaction avec les eaux souterraines. Intégrer ces techniques de maîtrise du risque dans les projets miniers permet d’augmenter considérablement la sécurité. Au Canada ou en Autriche, par exemple, des mines conçues de la sorte ne comptent plus d’accidents fatals.
« La vraie difficulté n’est plus tant technique aujourd’hui ; c’est plutôt de concevoir le projet minier comme un projet de territoire » explique le chercheur de Mines Nancy. Le modèle de l’enclave minière, c’est-à-dire une zone déconnectée de ses alentours, telle une base militaire, ne peut pas fonctionner selon lui. Si une mine ne peut pas être invisible, elle ne doit pas non plus chercher à l’être. Pour mieux gérer le risque, il est en effet important d’impliquer les populations locales, et non d’exclure les citoyens. Ces derniers sont parties prenantes dans la notion de risque. « Sans prendre en compte les différents acteurs, et notamment les aspects locaux, les projets miniers sont voués à l’échec » juge Yann Gunzburger.
Une controverse mêlant technique, société et politique
Dans les petites communes de Bretagne qu’étudie Julien Merlin, la non prise en compte des citoyens est exactement ce qui mobilise les associations locales. Les collectifs ont longtemps regretté de ne pas être inclus dans les dispositifs de concertation. Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) mettent pourtant bien en place des commissions d’information et de suivi liées à chaque permis d’exploration. « Mais les associations de riverains ne sont pas conviées aux réunions » observe le sociologue. Les discussions se font donc entre l’opérateur Variscan Mines, les mairies, les préfectures et des associations plus globales, comme Côtes d’Armor Nature Environnement, ou Eau et Rivière de Bretagne pour les concertations qui ont lieu en région Bretagne. « Ces associations plus grosses sont déjà thématisées autour de l’environnement lorsqu’elles sont invitées » rappelle Julien Merlin. Ce sont elles notamment qui ont fait émerger la question du danger du forage pour les aquifères. Mais en invitant uniquement des organismes régionaux ou nationaux, déjà spécialisés sur l’environnement, les revendications locales portant sur d’autres sujets ne trouvent pas toujours leur place dans les débats. Dans le cas de la mine de Couflens-Salau, la consultation citoyenne s’était résumée en 2016 à un vote en ligne. Et même en faisant appel à des associations environnementalistes, la question de l’amiante et des risques de santé publique aurait été de fait reléguée au second plan. Les processus de concertation se retrouvent alors eux-mêmes au centre du débat. Du choix des acteurs représentés et des sujets à aborder dépend l’orientation de la controverse.
La complexité du lien entre les revendications locales et les revendications globales est ce qui anime les recherches de Julien Merlin. Ses précédents travaux sur la controverse minière autour du plateau de Goro, en Nouvelle-Calédonie, avaient montré comment les questions environnementales, culturelles et politiques locales s’étaient rejointes pour porter une parole d’opposition cohérente. Dans le cas de la France métropolitaine, il continue de mettre à mal l’approche « NIMBY » qui résume la mobilisation locale à la simple défense d’une qualité de vie. NIMBY est l’acronyme de « not in my backyard », ou en français « pas dans mon jardin ». Les collectifs locaux portent des revendications qui vont bien au-delà de la volonté de ne pas voir une mine dans son paysage parce que ce n’est pas esthétique. « En Bretagne, les riverains ont des arguments de développement d’un tourisme vert, qui est selon elles incompatible avec les mines » mentionne le chercheur en guise d’exemple.
À lire sur I’MTech : Nouvelle Calédonie : la mine qui questionne la démocratie
Pour le gouvernement, cet argument économique régional reste moins important que celui de la souveraineté. Sécuriser les approvisionnements face à un éventuel blocage des pays miniers qui ont le monopole reste la priorité. L’Administration avance également une dimension éthique dans sa démarche : rouvrir des mines en France c’est justement pouvoir satisfaire aux impératifs de sécurité que des mines à l’étranger ne respectent pas. « La question de la souveraineté est donc aussi d’une certaine façon celle de la responsabilité » pointe Julien Merlin. Entre les parties prenantes, la complexité des arguments tient aussi du fait qu’ils ne se placent pas sur le même niveau. Concernant la dimension économique seulement, une opposition entre tourisme vert et souveraineté sur l’approvisionnement en matières premières peut difficilement être arbitrée. D’autant que pour répondre au gouvernement, certaines associations se placent parfois sur un plan à nouveau radicalement différent, comme celui de la décroissance économique.

Le long du Salat, la manifestation de l’opposition à l’exploration minière sur le site de Salau cible parfois directement la société Variscan Mines, ou son ancien directeur général Michel Bonnemaison. Photo : BV.
« Des collectifs critiquent l’idée même de l’activité minière et militent pour une alternative mettant l’accent sur les circuits de recyclage pour réutiliser les matières premières déjà en circulation » constate Julien Merlin. En décembre 2016, le rapport de la fédération des Amis de la Terre intitulé « Creuser et forer, pour quoi faire ? » insistait sur la nécessité d’allonger la durée de vie des produits pour limiter la consommation des métaux nécessaires à leur conception. En passant, le rapport mentionnait que 57 % des déchets électriques et électroniques échappaient à la filière de recyclage agréée. « Le taux de réemploi ne dépasse pas les 2 %. Nos déchets sont loin de renaître en nouveaux produits » écrivait ainsi l’association. Ce rapport est un document sur lequel s’appuient aujourd’hui de nombreux collectifs opposés aux mines. Il est présent dans les pages de documentation de leurs sites web, et montre ainsi à quel point le débat technique est aussi politique.
Pour les experts des pouvoirs publics, impossible de répondre à la demande en ressources minérales simplement grâce au recyclage, ne serait-ce qu’en raison de l’augmentation démographique sur la planète. « En réalité, il faudra encore des années de recherche pour trancher sur la possibilité ou non d’utiliser majoritairement le recyclage, d’autant que les filières de recyclage innovent en permanence » annonce Yann Gunzburger. « Pour certains alliages, c’est une question tellement complexe qu’il est impossible de dire aujourd’hui de manière définitive qui a tort ou raison. » En revanche, la focalisation d’une partie du débat sur les filières de recyclage donne à la controverse minière un aspect productif. « La soutenabilité du recyclage devient une question de plus en plus politique et scientifique, en partie grâce au débat minier » remarque Julien Merlin. Derrière des débats géographiquement très localisés se tiennent donc des enjeux politiques et sociétaux très forts.
« La caractéristique de la question minière, c’est que les controverses locales ne sont jamais que locales » souligne Brice Laurent, sociologue des controverses à Mines ParisTech. Les débats techniques sont la partie émergée d’un iceberg contestataire plus profond, à la fois politique et économique. Pour les associations, être inaudible dans les organismes de concertation est vécu comme un déni de démocratie. « Contrairement à d’autres controverses, comme les nanotechnologies, la question de la participation n’est pas toujours posée explicitement dans les débats du renouveau minier français » remarque le sociologue. Lorsque dans les années 2000 les programmes de politiques publiques sur les nanotechnologies ont été lancés, la Commission nationale du débat public a organisé des débats dans toute la France. « Un objectif participatif était explicite. Il s’est révélé problématique mais il était présent. Dans le cas des mines, cette dimension est moins visible » poursuit Brice Laurent.
La mine, et après…
Pourtant, il y aurait beaucoup à gagner à intégrer les populations locales dans les délibérations. Les recherches de David Salze à IMT Mines Alès sont en grande partie motivées par la question de « l’après-mine ». Il constate que les sites miniers les moins contestés sont ceux qui pensent le devenir de la mine dès le début du projet. « Il existe de très beaux exemples d’exploitations qui ont eu une seconde vie au service de leur territoire » signale-t-il. Des lieux sont entièrement revégétalisés et trouvent une renaissance en étant comblés par un lac, ou transformés en zone humide. Sur certains sites, le défrichement nécessaire pour mettre en place la mine est vu comme une opportunité pour créer une zone d’activité ou industrielle une fois les minerais tous extraits. En réfléchissant au devenir des exploitations dès le montage du projet, l’implication des populations et le dialogue sont facilités. C’est dans ces conditions que le projet minier peut devenir un projet de territoire.
« Pour cela cependant, encore faut-il connaître la mine qui sera construite » fait remarquer David Salze. Et impossible de le savoir sans connaître les minerais présents dans le sol. En se mobilisant dès la phase d’exploration des terrains, les citoyens se retrouvent dans une situation paradoxale. D’un côté, ils demandent à avoir des réponses sur les exploitations potentielles qui apparaîtront peut-être sur leur territoire avant que les forages ne commencent. Mais de l’autre, ils empêchent les expertises techniques d’accéder à la connaissance qui pourrait répondre à leurs interrogations. « Il n’est possible de répondre à leurs questions que si l’on connaît la nature du gisement, son tonnage, et comment il peut être exploité » résume le chercheur d’IMT Mines Alès. L’étude des arguments révèle que cette opposition à la production de connaissances sur le gisement est loin d’être primaire. « À Salau, certains opposants estiment que les expertises ne devraient pas être réalisées par des sociétés privées, car cela conditionne le territoire » révèle Julien Merlin. Une partie de la population mobilisée n’est donc pas en soit contre l’exploration, mais demande à ce que les informations soient produites de manière neutre, si tant est que cela soit possible.
Une fois les données d’exploration obtenues, les réponses peuvent être apportées. En combinant les méthodes d’analyse du cycle de vie et la méthodologie d’analyse du risque, David Salze développe de nouveaux outils de calcul d’impact d’une mine. « Nous créons des réseaux de mesure en temps réel pour évaluer en permanence des paramètres comme la matière en suspension dans les eaux souterraines, en amont et en aval de la mine, la teneur du milieu en hydrocarbures. Nous regardons comment les activités autour de la mine sont influencées. » Dès lors, les conséquences de la mine peuvent clairement être établies pour répondre aux citoyens.
Pour Jean-Alain Fleurisson, chercheur au Centre de Géosciences de Mines ParisTech, en dépit des connaissances qu’il est possible d’acquérir grâce aux moyens scientifiques actuels, le chemin à faire pour engager les populations est encore très long. « La France, dont l’économie a tellement tiré profit des richesses du sous-sol par le passé, compte aussi d’importantes séquelles minières sur son territoire » rappelle-t-il. Encore aujourd’hui, les anciennes mines d’uranium continuent d’agiter les débats. Les stériles miniers, minerais trop pauvres en matière radioactive pour être valorisés, ont été utilisés dans certains régions comme remblais par les particuliers pour les terrassements d’habitations. Par sa décomposition, l’uranium produit du radon, un gaz qui est l’une des principales sources radioactives auxquelles les humains sont exposés. Les caves des maisons construites sur des sols comprenant des stériles peuvent compter des concentrations de radon dangereuses.
À lire sur I’MTech : Uranium : un passé pas si stérile
Jusqu’en 2002, il était légal d’acheter ces stériles. Mais des directives ont revu à la baisse le seuil d’exposition des populations aux émissions radioactives. Certains stériles sont passés au-dessus de cette norme, déclenchant les inquiétudes des populations. La controverse technique devient alors aussi une controverse juridique. « Les mesures de concentration de radon sont contestées, de nombreux acteurs proposent leurs propres normes techniques face à la norme légale » observent Ghid Karam et Bérénice Chaumont, de l’équipe de Brice Laurent à Mines ParisTech. Le travail sociologique qu’elles effectuent sur ces anciens sites uranifères, dans le Limousin et en Bourgogne notamment, montre à quel point le débat est complexe. « Sans uniformisation des normes à l’échelle européenne puis nationale, avec une concertation des organismes techniques d’opposition, le dialogue paraît difficile » mentionne Ghid Karam.
Où en est le rapport de force ?
Qu’il s’agisse des stériles des mines d’uranium, ou des rapports mentionnant l’amiante dans la mine de Salau dans les Pyrénées, ces conséquences du passé minier engendrent de la défiance envers l’industrie extractive. La virulence du rejet des mines par les populations est telle que les permis d’exploration bretons attribués à Variscan Mines s’enlisent. « La société a quasiment décidé d’arrêter, et a transféré ses PERM à une entreprise anglo-saxonne » nous explique Julien Merlin. L’avenir minier des PERM de Silfiac, Merléac et Loc-Envel est donc flou. Les opposants continuent de demander une véritable annulation des projets, tandis que la position du nouveau propriétaire des permis demeure inconnue. La situation est plus ou moins similaire pour les autres permis attribués en France : les mouvements d’opposition ont réussi à ralentir les étapes de prospection. Pour la mine de Couflens-Salau en revanche, l’avenir apparaît plus complexe. « C’est peut-être le seul site où le débat va vraiment prendre de l’importance » pense le sociologue.

Derrière la porte d’entrée de la mine de Salau, plus de 20 km de galeries courent dans la montagne. Certains habitants sont favorables à une phase d’exploration, ne serait-ce que pour mieux connaître les risques que présentent les vestiges du site, et y remédier par une opération de nettoyage et réaménagement. Photo : BV.
Il faut dire que ce projet a la particularité de mobiliser des citoyens favorables à sa réalisation. « Pour certaines personnes, l’ancienne mine était le symbole d’un territoire industrialisé » observe Julien Merlin suite aux entretiens menés sur place. Le collectif PPERMS milite ainsi pour une exploitation responsable du gisement de Salau. Il porte une revendication économique ayant pour objectif de redynamiser la région. « Ils n’opposent pas tourisme et mine » remarque le chercheur. « Pour eux, ce n’est pas forcément incompatible dès lors qu’un certain nombre de précautions sont prises. » Cette position citoyenne est particulièrement atypique. Sur les autres sites controversés, de tels arguments sont en général formulés par les sociétés minières. C’est le cas de Variscan Mines en Bretagne. Les positions citoyennes ne sont donc pas uniformes à l’échelle du pays. Elles dépendent des opinions économiques et politiques des habitants locaux. « C’est là que la dimension économique du débat prend de l’importance : parfois des individus vont considérer qu’ils sont dans une région économiquement sinistrée, ce qui va orienter leur regard sur un projet minier » souligne Julien Merlin.
Dans le cas ariégeois, l’incertitude tient plus au rapport de force entre les collectifs sur place. À mesure que les tensions montent, les arguments dépassent la simple question de santé publique. Est-il économiquement rentable de rouvrir une mine à Salau ? Quelle serait la conséquence pour le tourisme ? Quelle forme prend la responsabilité des industriels et du gouvernement ? Cette dernière question est particulièrement cruciale, car de la notion de responsabilité dépend aussi la construction du dialogue entre les différentes parties prenantes. En ce sens, Brice Laurent rapproche le concept de mine responsable de celui d’innovation responsable. « Il y a deux façons très différentes de faire fonctionner l’innovation responsable : l’une à la frontière du greenwashing, qui est de faire un projet et une fois qu’il est terminé de mettre une couche d’études d’impact pour faire en sorte qu’il soit accepté. L’autre qui consiste à dire qu’on ne sait pas au départ ce que sera une mine responsable, et de vraiment poser la question avec tout le monde, quitte à se rendre compte pendant le processus que tel projet de mine n’est pas acceptable pour un territoire donné. »
Enfin, pour les opposants sur place dans la vallée du Salat, il est aberrant de reprendre une exploitation minière alors qu’une réforme du code minier est en cours depuis de nombreuses années. La législation minière doit en effet encore être harmonisée avec le code de l’environnement. Sachant que le code minier est aujourd’hui très axé sur la gestion de l’après-mine — c’est-à-dire sur la réhabilitation des sites notamment — autorités publiques et industriels concèdent qu’il est nécessaire d’intégrer les aspects relatifs à l’exploitation pour mieux encadrer les activités de prospection et d’extraction. Et une fois que les deux codes auront été harmonisés, que se passera-t-il ? L’argumentaire des associations locales et des ONG sera-t-il mis à mal ? Difficile de le prévoir… Toujours est-il que jamais la nécessité de faire aboutir la réforme du code minier n’aura été si pressante ; et la temporalité jamais aussi pertinente. Si des débats parlementaires venaient à voir le jour, nul doute que les cas de mobilisation observés en Bretagne ou dans les Pyrénées nourriront les débats.
[box type= »info » align= » » class= » » width= » »]
Un réseau scientifique pour étudier la mine et son impact
Les chercheurs interviewés dans cet article (Jean-Alain Fleurisson, Yann Gunzburger, Brice Laurent, Julien Merlin et David Salze) font partie du Réseau d’Excellence (REx) Mine & Société. Ce réseau a été créé en 2014 pour pallier le manque d’une expertise scientifique académique et interdisciplinaire coordonnée sur la question minière. Il rassemble des compétences françaises pour comprendre et anticiper les besoins de la société civile, des pouvoirs publics et de l’industrie dans le secteur des matières premières. Le champ d’étude du réseau Mine & Société comprend bien entendu le territoire national, mais s’élargit à l’Europe, et à l’ensemble des pays miniers dans le monde. Font partie du réseau : IMT Mines Alès, Mines Nancy, Mines ParisTech, Géologie Nancy et Armines – en tant que membres fondateurs – et, à ce jour, 22 adhérents comprenant des industriels, des bureaux d’études, des institutions publiques, des établissements universitaires, des associations, etc.
Comme le précise Jean-Alain Fleurisson, « Le REx Mine & Société poursuit 4 objectifs principaux :
- Continuer à développer de l’innovation dans le domaine du Génie minier
- Produire de la connaissance scientifique (R&D sociétale) à travers de la recherche multidisciplinaire associant les sciences humaines et sociales aux approches d’ingénierie plus classiques des projets miniers
- Former et aider à former à différents niveaux (cursus initial, formation continue pour les professionnels de l’industrie minière, de l’administration et des établissements universitaires) pour renforcer savoir-faire et expertise pour mieux répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et humains de l’industrie minière
- Informer tous les acteurs mobilisés autour des projets miniers pour permettre des prises de décision éclairées sur la mise en oeuvre de ces projets miniers et faire en sorte qu’ils soient intégrés le mieux possible dans leur territoire. »
[/box]











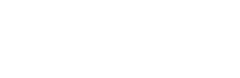
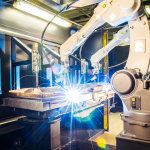

Trackbacks (rétroliens) & Pingbacks
[…] Des mines en France ? Une controverse entre technique et territoire (imtech-test.imt.fr, le […]
[…] Des mines en France ? Une controverse entre technique et territoire […]
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !